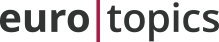L'Église doit-elle être politique ?
En Allemagne, dans une interview accordée à l'occasion de Pâques, la présidente du Bundestag Julia Klöckner (CDU) a critiqué le fait que les Églises s'expriment trop souvent sur des sujets d'actualité. Au lieu de se comporter "comme des ONG", elles devraient plutôt se concentrer sur l'action pastorale, a déclaré Klöckner. Par delà de cette polémique et sur fond de mort du pape François, la presse internationale se pose également la question de savoir si et comment les Églises doivent prendre position politiquement.
Faire silence ne serait pas conforme à la Bible
Pour le Tagesspiegel, les Églises se doivent bien évidemment d'être politiques :
«'Recherchez le bien de la ville', telle a toujours été la mission des Églises. Ces paroles sont celles d'un prophète, Jérémie, tirées de la Bible. Et celle-ci est politique puisqu'elle se rapporte de manière générale à la vie quotidienne, à chacun des individus. La loi fondamentale [Constitution allemande] n'adhère-t-elle pas elle aussi aux valeurs de l'Occident chrétien ? Si les Églises s'expriment sur la politique environnementale, c'est au sens d'une mission de préservation de la création. Si elles s'expriment sur la migration, c'est dans l'esprit de la Bible, ce livre rempli d'histoires de fuite et d'expulsion. Il ne serait pas très chrétien de ne pas s'en souvenir et de ne pas agir en conséquence.»
La vision de l'homme est éminemment politique
Handelsblatt réfute la position de Klöckner :
«La déception que trahissent les paroles de Klöckner est de nature plus politique que théologique. La CDU/CSU semble avoir du mal à digérer les récentes critiques de hauts-représentants des Églises sur la politique migratoire de Friedrich Merz. Ce serait pourtant le rôle d'une politique qui se dit chrétienne de réagir à cette critique, au lieu de vouloir museler les langues. Car qui est mieux placé que les Eglises pour prendre position sur les questions d'humanisme, d'exode ou de justice ? ... Contrairement aux partis, les Églises ne peuvent pas ajuster leurs principes à la petite semaine ni au gré des sondages. La vision chrétienne de l'homme n'est pas négociable et elle ne fait pas de différence entre les réfugiés de première ou de seconde classe.»
Pour plus de profondeur théologique
Frankfurter Allgemeine Zeitung a un avis partagé sur la question :
«Le problème n'est pas le fait en soi que les Églises prennent position sur l'actualité politique, mais le message qu'elles propagent à proprement parler – et celui qu'elles taisent. On constate en effet que souvent, ce sont surtout des prises de position superficielles et éphémères qui sont montées en épingle : des réflexes politiques plus que des réflexions théologiques profondes. La parole de Dieu y transparaît à peine. C'est pourtant ce dont on aurait cruellement besoin en temps de guerres, d'exodes et d'épidémies. Beaucoup de prêtres portent cette parole de Dieu, mais ils le font en grande partie soit dans des églises vides, soit au chevet à domicile, à l'hôpital, dans les prisons ou sur le front. En toute humilité et sans porte-voix. C'est là la véritable Église. Elle doit exprimer sa parole. Et ce n'est pas en tant que groupe de pression politique qu'elle subsistera – mais uniquement en embrassant la mission qui est la sienne, dans le recueillement.»
Le pape François a fait l'autruche
Selon l'avis de Kauno diena, le défunt pape aurait dû prendre des positions plus politiques :
«François a décidé de n'être qu'un disciple du Christ et a refusé de jouer le rôle d'un des hommes les plus influents du monde. Cette dichotomie s'est manifestée dans la bénédiction de Pâques Urbi et Orbi rassurante prononcée au début de la pandémie, tout comme dans sa neutralité face à l'agression russe. Le pape n'a pas pu surmonter son idéalisme de gauche et n'a engagé aucune des réformes attendues en Occident. ... Il laisse à son successeur une communauté divisée par un fossé de plus en plus visible, avec d'une part un monde moderne à la recherche d'autres dieux et d'autre part une foule croissante de chrétiens fidèles d'Afrique et d'Asie cherchant refuge dans le catholicisme traditionnel.»
L'opposition comme devoir
La Stampa réfute les accusations selon lesquelles le défunt pape n'était pas favorable à l'Occident :
«François, le pape de la peine, de la douleur et de la souffrance, était-il vraiment un ennemi de l'Occident libre, riche et consumériste ? Comme elle est étrange, cette ombre collante que Bergoglio traîne derrière lui depuis le début de son pontificat, dans un monde qui s'enfonce dans un tourbillon de paroles fausses et creuses. Cette opposition lui est reprochée par beaucoup. Comme si ce n'était pas justement le rôle de l'Église d'être contre, d'être obstinément et en permanence contre ; et non pas de s'agenouiller devant le monde. ... Une question est d'ailleurs encore plus radicale : où est cet Occident prétendument lumineux ?»
Un devoir de résistance plus actuel que jamais
Le nouveau pape devrait lui aussi s'opposer au nationalisme et à l'autoritarisme, défend The Guardian :
«François a parfois paru isolé lorsqu'il s'est opposé aux nouveaux courants autoritaires dans la politique occidentale. Il a déploré la montée des nationalismes agressifs et l'érosion des normes démocratiques, devenant ainsi un rempart solitaire mais important de la résistance au nom des droits et des valeurs universels. Les forces progressistes à l'intérieur et à l'extérieur de l'Église doivent espérer que le prochain pontife pourra s'appuyer sur cet héritage à une époque instable et dangereusement volatile.»