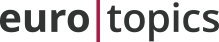Ukraine : comment interpréter la fragile trêve pascale ?
Le samedi saint, Vladimir Poutine a annoncé une trêve de 30 heures, qui a aussi été adoptée par l'Ukraine. Si elle n'a été que partiellement respectée sur le front, les deux camps ont renoncé aux attaques aériennes. Alors que Washington menace de mettre fin à la médiation américaine si les belligérants ne faisaient pas preuve de bonne volonté, les chroniqueurs discutent de ce développement.
L'Europe doit poursuivre son soutien
Dans cette guerre, Kyiv ne peut compter que sur elle-même et sur l'Europe, souligne Ilta-Sanomat :
«Seule l'Ukraine et les pays européens qui la soutiennent semblent réellement vouloir obtenir une paix équitable, tandis que la Russie veut poursuivre sa guerre de conquête et que l'actuelle administration américaine, pour des raisons qu'elle est la seule à connaître, veut précipiter la fin de la guerre, sans se soucier des modalités ou du sort de l'Ukraine. Le pays n'a pas d'autre choix que de continuer à se défendre, et l'Europe n'a pas d'autre choix que de continuer à soutenir l'Ukraine et de renforcer sa propre défense.»
Une once de confiance
Dans un post Telegram repris par Ekho, la journaliste Farida Roustamova fait état d'un rapprochement des belligérants dans le sens d'une entente pour la période de Pâques :
«Zelensky et Poutine ont confirmé une certaine accalmie dans les combats dans les deux camps. ... Poutine n'a pas rejeté sur Kyiv la responsabilité de l'échec d'une trêve pascale. Zelensky a fait savoir que l'Ukraine n'avait pas subi d'attaque aérienne dimanche, et que 'ce format d'accalmie était le plus simple à perpétuer'. Il a proposé à la Russie de s'entendre sur un moratoire de 30 jours sur les attaques sur des cibles civiles. Poutine n'a pas entièrement rejeté la proposition. Fait surprenant, il n'a pas exclu tout contact direct avec l'Ukraine sur cette question. ... On ressent comme une confiance mutuelle, à des doses homéopathiques.»
Un message à Washington
Dans la matinale de France Inter, le chroniqueur Pierre Haski y voit surtout un signal adressé au président américain :
«Ces annonces de trêve sont d'abord de la communication. ... Cette fois, c'est Poutine qui envoie un message à Trump. 24 heures avant l'annonce de trêve russe, le président américain s'était montré agacé par l'absence de progrès dans les négociations visant à mettre fin à la guerre en Ukraine. Le 'roi du deal', qui avait promis la paix en 24 heures, est dans l'échec, et son administration a menacé de tout envoyer balader si les choses n'avancent pas. Moscou et Kyiv redoublent donc d'efforts pour qu'en cas d'échec, ce soit l''autre' camp qui en porte la responsabilité.»
Trump et Poutine dépassés par les enjeux
Emilian Isaila, journaliste à Spotmedia, ne croit pas que les Etats-Unis abandonneront l'Ukraine :
«Je ne pense pas que Trump aura le courage de couper les aides à l'Ukraine comme il l'a déjà fait, ce qui avait entraîné des tensions au sein de son cabinet début mars, avant qu'il ne revienne sur sa décision. Trump ne peut pas prendre le risque politique de se voir accusé par l'opposition de la mort d'innocents en Ukraine par sa faute. Il sera intéressant de voir, ces prochains jours, quelle sera la réaction de Poutine. Le chef du Kremlin acceptera-t-il que Trump se retire des négociations ? Selon moi, cela placerait le président russe devant un danger tel qu'il s'y opposera. L'avenir nous dira de quelle manière il s'y opposera.»
Une paix difficile sans force tierce
Dans Bernardinai, l'expert militaire et major de réserve Darius Antanaitis explore la possibilité de parvenir à la paix sans médiation de Washington :
«Un accord de paix durable sans la participation des Etats-Unis est théoriquement possible, puisque in fine, c'est entre l'Ukraine et la Russie que les négociations devront avoir lieu. Est nécessaire, néanmoins, la médiation d'une force tierce, qui dispose de suffisamment d'influence pour se faire entendre par les deux camps. Un cessez-le-feu durable et un accord solide seraient donc envisageables sans les Etats-Unis – car ce dont l'Ukraine a besoin avant tout, c'est d'une garantie de sécurité durable. Une garantie que pourrait par exemple également apporter la Chine, si l'on fait abstraction des Etats-Unis.»